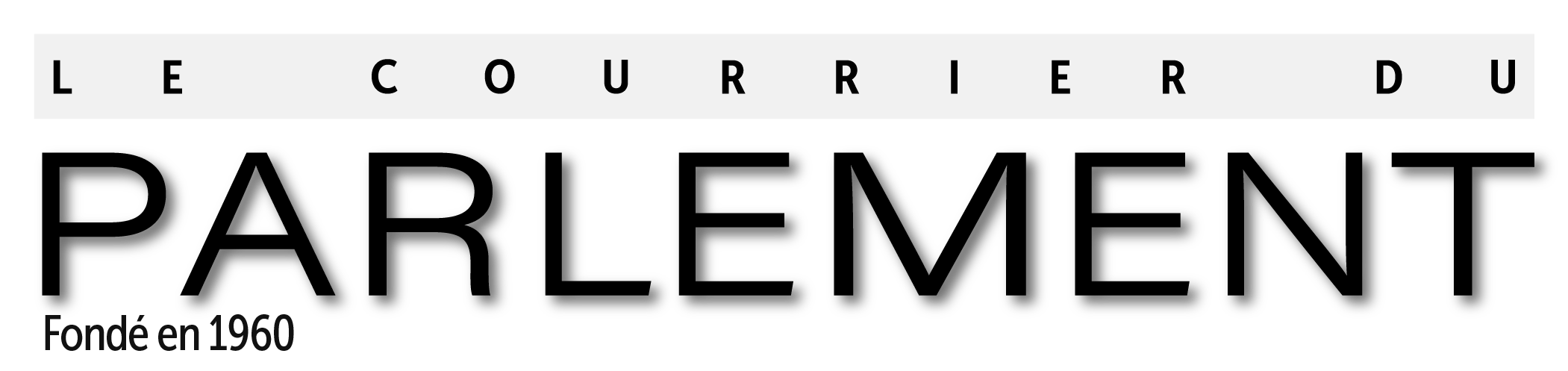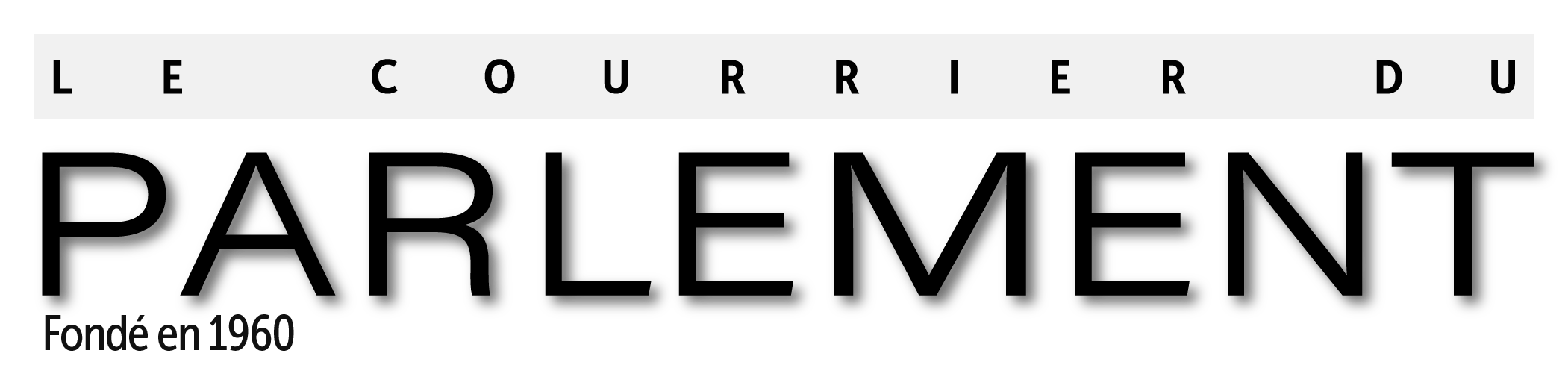A la suite de deux semaines de débats, l’Assemblée nationale a donné son feu vert aux deux propositions de loi relatives à la fin de vie. La première concerne les soins palliatifs tandis que l’autre, hautement plus sensible, légalise « l’aide à mourir ».
« Rarement dans l’histoire récente de cette Assemblée, un sujet aussi grave n’aura été débattu avec autant de respect et d’écoute ». C’est ce qu’a affirmé Agnès Firmin-Le Bodo, députée Horizons et ancienne ministre de la Santé à l’issue du vote. Et pour cause : si la plus consensuelle des deux lois – traitant des soins palliatifs – a été votée à l’unanimité (560 voix pour, 0 contre), une étape importante a elle aussi été franchie avec l’approbation à 305 voix pour et 199 contre du « droit à l’aide à mourir », d’après le président Emmanuel Macron. Du côté du gouvernement, la ministre de la Santé Catherine Vautrin espère bien que ce texte sera entériné avant la présidentielle de 2027.
Chez les professionnels, les sons de cloche diffèrent. L’Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD), qui défend cette réforme depuis un certain temps déjà, s’est notamment réjouie « pour celles et ceux (…) qui perçoivent l’espoir d’une fin de vie maîtrisée, épargnée des souffrances inapaisables et des agonies inutiles ». Chez les soignants de la société française d’accompagnement et de soins palliatifs (Sfap), le discours est tout autre : « ce texte sur l’aide à mourir ne répond pas à des situations d’exception mais instaure une nouvelle norme du mourir ». Une « vive inquiétude » que partage la conférence des évêques de France (CEF) face à cette réforme sociale majeure, sur laquelle le Sénat devrait se prononcer d’ici la fin de l’été.