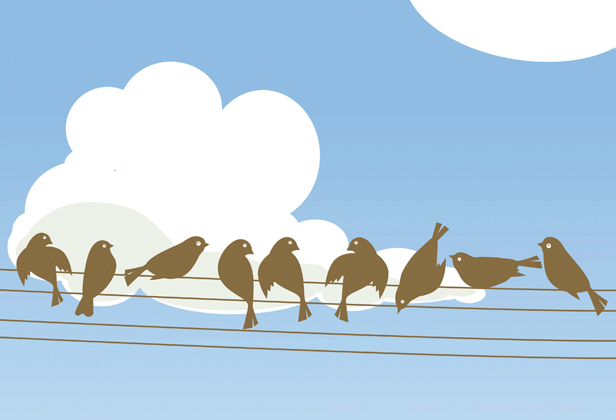
Les fameuses “niches” fiscales seront-elle un jour rebaptisées “pigeonniers” ? C’est la question que l’on peut se poser après la fronde dite “des pigeons”, les créateurs d’entreprise du Net s’étant comparés au fameux volatile dont le nom qualifie familièrement “celui qui se laisse duper”. Le gouvernement et les parlementaires ont été en effet invités à modifier la loi de finances 2013 qui prévoyait de surtaxer (jusqu’à 63 %) les recettes de plus-value dégagées par la vente d’une entreprise. Cette mesure participe certes d’un tour de vis fiscal général mais elle se heurte à une réalité sociologique contemporaine. Il va falloir inventer un dispositif – le mot “niche” étant devenu tabou – susceptible de laisser au rêve de richesse la bride sur le cou.
Jeunes entrepreneurs parmi les plus motivés en France, aujourd’hui, ils travaillent dans un secteur où les profits sont souvent virtuels jusqu’à ce qu’arrive la récompense suprême : la fameuse “culbute” lors d’une revente, de préférence à un grand groupe. Ce n’est qu’à ce moment-là que seront validés les concepts ayant permis à l’entreprise d’exister et que seront remboursés les investisseurs et les banquiers. La différence entre les montants dus aux prêteurs et le prix de vente créera alors le bénéfice de l’entrepreneur, souvent équivalent à celui d’un “jackpot” au loto. Des milliers de jeunes sociétés, financées de bric et de broc, souvent à l’aide de “love money” (l’argent des parents et des amis), innovent et inventent chaque jour, sans rentabilité immédiate, dans des locaux modestes et avec des salaires étriqués, dans l’espoir de cette “culbute” miraculeuse qui, selon une étude récente, ne concernerait qu’une entreprise sur dix. Les autres disparaissent avec plus ou moins de passif au bout de quelques années ou s’insèrent plus modestement dans les circuits de l’économie classique avec une rentabilité régulière mais non mirobolante.
Les groupes financiers faisant régulièrement leur marché parmi les start-up du e-commerce ou de la communication en ligne achètent, quant à eux, plus une marque, une notoriété, un concept innovant et un fichier de visiteurs identifiés que de véritables “machines à cash”. En reprenant à leur compte les promesses de bénéfice sur lequel le ou les créateurs fondaient leurs espoirs, ils espèrent passer pour leur part du virtuel au réel, soit par injection de capitaux supplémentaires, soit en synergie avec d’autres acquisitions déjà réalisées. L’effet de mode joue à plein. Un conglomérat comme celui d’Arnaud Lagardère, construit à partir de l’aéronautique, des industries de défense et de la presse magazine, n’imagine plus son développement qu’au travers d’une myriade d’acquisitions dans la “net-économie”.
Bons connaisseurs de réseaux sociaux
L’existence des “nouveaux entrepreneurs” réclame donc un doigté imprévu aux hommes politiques, notamment de gauche, dans leur approche psychologique des acteurs de la réalité économique contemporaine. On ne saurait parler, à propos du vaste ensemble constitué par ceux qui se baptisent “les pigeons”, de “monde patronal” ou de “partenaires sociaux”. Les créateurs de start-up n’ont ni la conscience de classe ni les réflexes managériaux des capitalistes classiques. Beaucoup ne rêvent que de “culbute” et essaient de faire partager ce songe doré à leurs salariés, qui sont souvent leurs amis, en les rémunérant avec des actions. Cet univers cultive ses îcones et ses rites, avec une admiration sans borne pour les américains comme Marc Zuckerberg, le fondateur de Facebook, plus jeune milliardaire de toute l’histoire de l’humanité puisqu’il se trouvait à vingt-huit ans, en 2011, à la tête d’une fortune estimée à 17 milliards de dollars. En dépit du fait que, depuis l’introduction en bourse de Facebook le 18 mai dernier – opération très profitable au fondateur et à ses associés – la valeur de l’action a été divisée par deux…
Cela pourrait être un monde à part. Mais la sphère politique ne peut se permettre de l’ignorer. Ces professionnels de l’Internet connaissent l’art et la manière de faire monter n’importe quelle mayonnaise sur la toile. Beaucoup ont d’ailleurs été sous contrat, via une cascade de sous-traitants, début 2012, avec les équipes de campagne de François Hollande ou de Nicolas Sarkozy afin de gérer les sites des candidats. Le lancement de l’opération “Pigeons” a d’ailleurs été un modèle du genre. À partir de la réflexion d’un internaute (installé… en Californie !) sur Facebook, un graphiste a proposé le dessin d’un pigeon et l’affaire a prospéré à la manière d’un feu de pinède par un été sec. Au départ simple coup de colère contre la taxation à 62 % de la plus-value de revente d’une entreprise, le mouvement s’est aussitôt découvert des alliés comme le Medef – qui ne voulait pas passer à côté de la modernité – et, naturellement, des partis ou des sites de l’opposition.
Au gouvernement, l’affaire a été prise au sérieux. D’où des apaisements immédiats avant la discussion de la loi de finances. Le grand problème est en effet celui de la cohérence de l’action publique. Comment faire croire à la volonté de créer un “choc de compétitivité”, notamment par le développement de l’innovation dans les PME, si les jeunes chefs d’entreprise reçoivent de mauvais signaux ? Il n’est pas facile de se sortir politiquement des remous créés par des couacs de ce genre. Car il faut aussi gérer les conséquences liées au fait de donner l’impression d’avoir reculé…
Dans le sillage laissé dans le ciel des idées par les “pigeons” reviennent aussi quelques récurrentes interrogations de société. Elles ne datent pas d’aujourd’hui. Les Français aiment-ils les entrepreneurs ? L’économie numérique n’est-t-elle pas un leurre, dont l’apparente prospérité cache la désindustrialisation du pays ? Ce sont là des sujets inépuisables pour talk-shows à la télévision.
L’industrie recrute
Pour que les Français aiment les entrepreneurs, il faudrait qu’ils en connaissent beaucoup et qu’ils aient la possibilité de les rencontrer souvent, notamment lors des recherches d’emploi. Malheureusement, la transformation rapide du tissu industriel sépare, notamment sur les territoires jadis très industrialisés, les employeurs des employés. Le “patron” de PME n’est plus, de toute façon, le notable qu’il était. C’est souvent aujourd’hui un chef de tribu qui vit beaucoup avec ses collaborateurs et gagne à peu près la même chose qu’eux à la fin du mois. Il est vrai que sa principale motivation tient dans la perspective, souvent déçue, d’une mirifique revente qui justifie à la fois les risques et les sacrifices… Quant à la séparation entre l’économie numérique et la production industrielle, elle tend à s’effacer. Les sites en ligne les plus prospères sont ceux qui écoulent des produits manufacturés. À ce titre, ils perturbent plus le commerce traditionnel que l’industrie, pour peu que celle-ci soit, de son côté, suffisamment innovatrice.
Les “plans sociaux” donnent une image inexacte, par ailleurs, de la réalité industrielle. Parce que l’on ferme des hauts fourneaux en sacrifiant une partie de la main d’œuvre qui les fait fonctionner, un débat irréel sur les “coûts du travail” donne aux jeunes l’impression que l’industrie ne crée plus d’emploi ou peine à rémunérer correctement ses salariés. D’où l’idée qu’il faut à tout prix réussir dans les métiers du Net qui peuvent pourtant se révéler aussi de parfaits miroirs aux alouettes. En réalité, des secteurs entiers recrutent activement si l’on en croit les données de Pôle emploi : métallurgie, chimie et pharmacie ont du mal à pourvoir les emplois offerts, souvent parce qu’ils ne se trouvent pas aux mêmes endroits que les usines qui ferment.
Dans une interview accordée au journal Le Monde (9/10/12), Jean-Louis Levet, conseiller auprès du commissaire à l’investissement remarque : “Au XXIe siècle, trois cercles industriels se distinguent finalement. Un premier correspond à l’industrie manufacturière au sens strict et englobe tous les services qui y sont liés. Un deuxième comprend les industries de réseau – les télécoms, les transports, l’électricité – qui se développe rapidement. Enfin, un dernier cercle inclut les produits futurs issus des nouveaux domaines de recherche comme la biotechnologie et les nanotechnologies et qui répondent aux grands besoins de demain : la mobilité, l’habitat, l’éducation et la santé. Selon cette définition large, l’industrie, c’est 35 % à 40 % de notre PIB, loin des 14 % des statistiques classiques.”
Considérer qu’il y aurait une “économie de l’immatériel” destinée à prendre le pas sur la production de biens matériels serait une grave erreur. C’est pourtant ce qu’il risque de se passer si le gouvernement et la majorité parlementaire accordent une forme d’exception fiscale aux créateurs de société du Net qui ont d’ailleurs été rejoints par les “auto-entrepreneurs” qui considèrent, à tort ou à raison, que leur statut – institué sous Nicolas Sarkozy – est menacé. Le “mouvement des pigeons”, qui n’est pas sans rappeler – l’effet “Buzz” en plus – les frondes poujadistes de jadis, pose un problème délicat à un nouveau pouvoir qui ne s’est pas montré aussi intransigeant sur les “niches fiscales” que d’aucuns le redoutaient. Les œuvres d’art, les investissements dans le cinéma ou les DOM-TOM gardent une fiscalité privilégiée. La “Net-économie” et ses jeunes patrons seront-ils aussi un jour parmi les choyés ? Un beau casse-tête politique en perspective.

