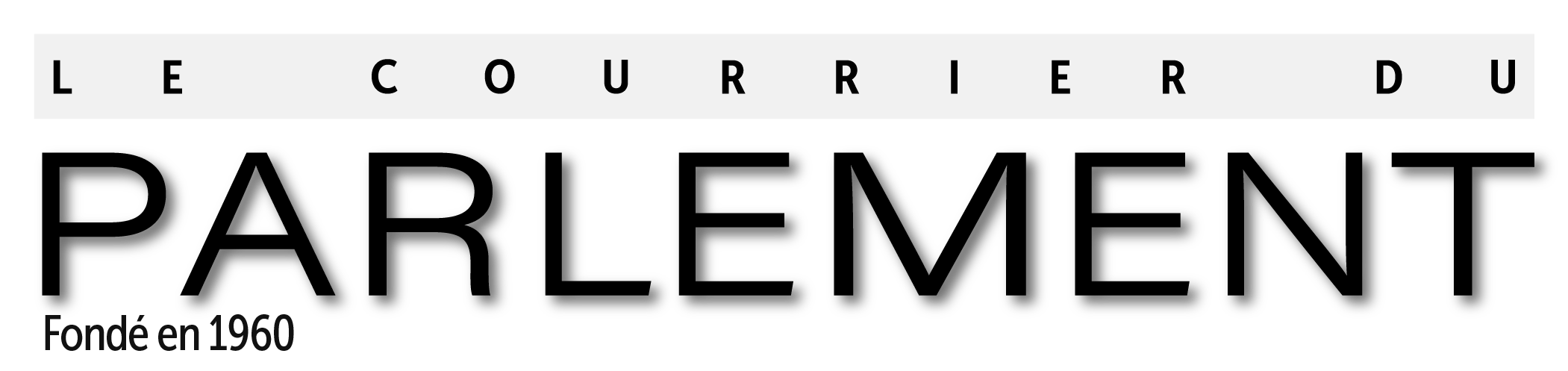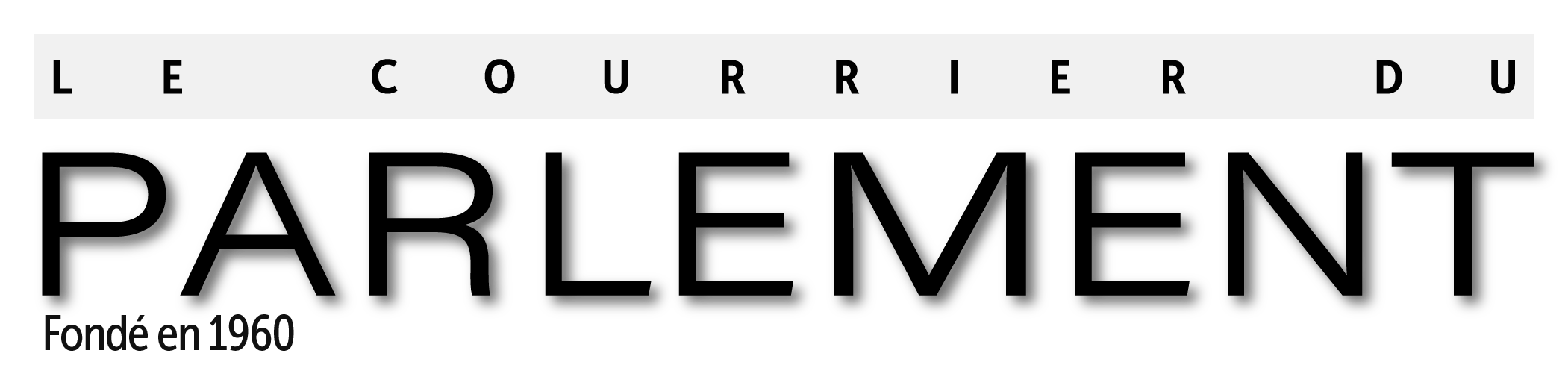L’annonce du départ en Nouvelle-Calédonie d’Emmanuel Macron donne à penser qu’un nouveau chapitre est susceptible de s’écrire dans l’histoire tumultueuse de ce territoire français. Cela semble plus que nécessaire pour sortir des nostalgies et autres rancoeurs. Le « caillou », comme on l’appelle familièrement, s’était inscrit en lettres de sang dans l’actualité des années quatre-vingt. Tuerie de Hienghène, carnage de la grotte d’Ouvéa, élimination brutale du leader indépendantiste Eloi Machoro, assassinat de Jean-Marie Tjibaou : les journalistes qui ont couvert ces événements n’ont pas besoin de faire grand effort de mémoire pour que des images cauchemardesques leur reviennent aujourd’hui à l’esprit en constatant le retour de la violence. Avec elle refleurissent aussi les comparaisons qui ne sont pas raison – la guerre d’Algérie ! – et la résurgence des explications toutes faites émanant de gens qui, pour la plupart, n’ont jamais entrepris le long voyage (un aller et retour réclame au minimum cinquante heures d’avion) permettant de se faire une idée de la réalité sur place.
Aujourd’hui comme hier, commenter et a fortiori décider que Paris s’expose à prendre parti sans vraie réflexion et à négliger la complexité d’un archipel magnifique dont la population est équivalente en nombre (270 000 habitants) à celle d’une agglomération métropolitaine de taille moyenne. Dans un décor qui inviterait plutôt à l’insouciance tant il est magnifique en certains endroits, existe une spécificité qui s’appelle l’angoisse. Elle est partout comme pour mieux démontrer qu’il n’y a pas de paradis sur terre. La grande peur ancestrale des mélanésiens, c’est de subir le sort des aborigènes historiquement décimés dans l’Australie voisine. Les européens, qu’ils descendent de bagnards, de déportés politiques de colons ou de fonctionnaires, intériorisent pour leur part la menace d’être considérés comme d’odieux colonialistes susceptibles d’être chassés de chez eux sous la double pression des autochtones et des militants progressistes du monde entier. Les nombreux membres des communautés asiatiques craignent, enfin, d’être conduits à revoir à la baisse leur espoir d’intégration dans un ensemble français garantissant état de droit et prestations sociales.
Vaille que vaille, depuis les « accords de Matignon » de 1988 inspirés par la fine dentelle référendaire imaginée par Michel Rocard, la paix s’était maintenue. Elle avait été obtenue, rappelons-le, en bousculant nos traditions politico-administratives. Il avait été tenu le plus grand compte des échanges entre des personnes susceptibles d’exercer une influence, qu’il s’agisse des prêtres catholiques et des pasteurs protestants, des francs-maçons, des acteurs de l’économie et, naturellement, des autorités coutumières. Ajoutons des fonds publics généreux et une perspective de redistribution des cartes économiques entre les régions nord et sud. La récente modification des listes électorales, en revanche et quel que soit son bien fondé, a été élaborée en minimisant les aspirations des membres de la génération mélanésienne montante alors même que des « influenceurs » étrangers cherchent à les manipuler contre la France. Il est clair qu’une nouvelle « mission du dialogue » s’impose et, plus encore, que le président de la République sache se comporter en arbitre attentif et bienveillant.