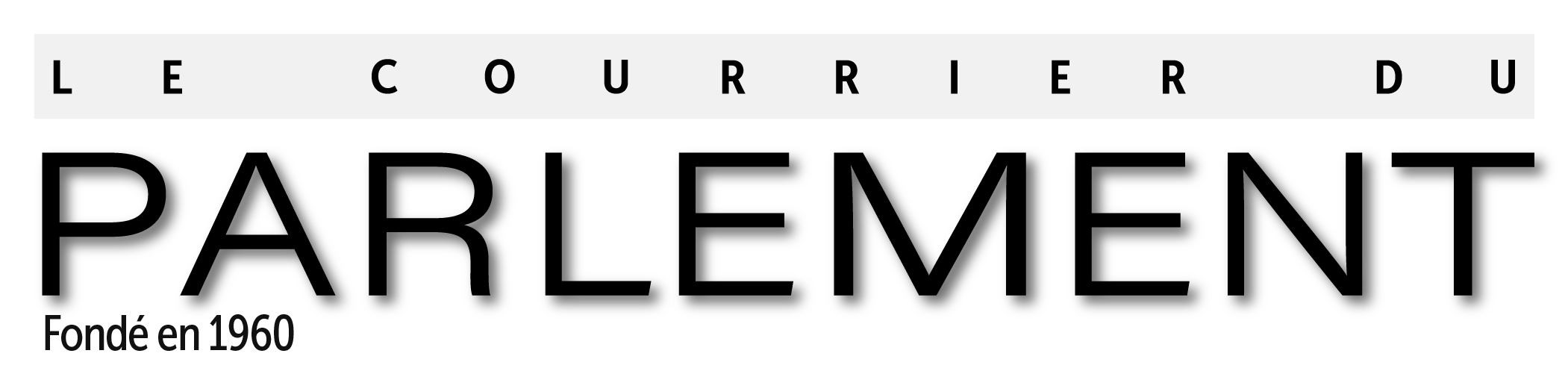Dans le cadre de l’examen du budget 2026, la commission des lois du Sénat a auditionné mercredi 19 novembre Naïma Moutchou, ministre des Outre-mer. Au cœur des échanges : la situation explosive en Nouvelle-Calédonie, encore meurtrie par les émeutes de 2024 et engagée dans un processus institutionnel inédit depuis l’accord de Nouméa.
La Nouvelle-Calédonie bénéficie d’un statut juridique “sui generis”, ni département d’outre-mer classique, ni territoire soumis au droit commun. Cette singularité est héritée d’une histoire marquée par les tensions entre indépendantistes kanaks et loyalistes, que l’accord de Nouméa (1998) avait tenté de canaliser via un processus d’émancipation progressive. Depuis, pas moins de trois référendums ont été soumis à la population concernant son autodétermination : chaque fois, le “non” l’a emporté. En 2021, l’abstention atteignait un taux de 56,3%, illustrant la contestation autour d’un débat qui cristallise encore des divisions historiques sur « le Caillou ».
Ce fragile équilibre a volé en éclats en 2024 avec les violentes émeutes liées au projet de dégel du corps électoral, perçu par les indépendantistes comme une tentative de réduire leur poids politique. Le bilan est lourd : 14 morts et près de 1 000 blessés. Pour sortir de l’impasse, le président Emmanuel Macron a réuni en juillet 2025 un conclave à Bougival, associant État, indépendantistes, loyalistes et acteurs économiques. Un accord en est sorti : sans être “unanimement porté, il est majoritairement soutenu” à en croire la ministre des Outre-mer Naïma Moutchou, qui s’est rendue sur place afin d’obtenir des avancées avec cinq des six forces politiques locales, excepté le FLNKS (Front de libération nationale kanak et socialiste), L’objectif central étant de redonner toute sa force à cet accord via la consultation des Calédoniens.
Une consultation citoyenne en mars 2026
Interrogée par plusieurs sénateurs, notamment Agnès Canaillet, Naïma Moutchou a confirmé qu’une consultation citoyenne relative à l’accord de Bougival serait soumise directement aux Calédoniens.
Celle-ci sera précédée d’un texte législatif présenté lors d’un conseil des ministres en décembre, avant un examen du projet au Sénat début janvier afin de rentrer dans les délais prévus. Le report des élections provinciales à fin juin 2026 devrait être maintenu. Toutefois, cet exercice démocratique, hors cadre constitutionnel, a été jugé fragile par certains parlementaires, qui ont évoqué un “numéro d’équilibriste” et mis en doute sa valeur juridique. La ministre s’est voulue rassurante face à ces inquiétudes, répondant qu’à l’instar des précédents référendums, un document explicatif officiel détaillerait les conséquences d’un “oui” ou d’un “non”.
La stabilisation de l’avenir institutionnel calédonien
La Nouvelle-Calédonie “ne peut pas supporter l’immobilisme” a ajouté Naïma Moutchou. Si le budget 2026 est contraint par l’effort global de réduction du déficit public, les Outre-mer affichent une copie acceptable avec des moyens stabilisés : 24,9 milliards d’euros en autorisations d’engagement et 26,8 milliards d’euros en crédits de paiement.
La reconstruction calédonienne bénéficie de plusieurs leviers avec une part considérable des 48 millions d’euros dédiés aux établissements scolaires ultramarins. De même, l’archipel pourra compter sur la mobilisation du fonds de reconstruction et des contrats de convergence. Sans oublier des actions attendues sur la maîtrise des prix et le renforcement des filières locales dans un territoire aux importations coûteuses et à la dépendance logistique chronique-.
Plusieurs élus dénoncent cependant des insuffisances, à commencer par la députée socialiste Corinne Narassiguin qui déplore une aide spécifique encore trop faible, un recul de la commande publique au profit d’un “environnement récessif”, tout comme de graves manques en matière de sécurité, de justice et d’infrastructures pénitentiaires.
L’accord de Bougival envisageait pourtant bien la création d’un nouvel établissement pénitentiaire. Le gouvernement semble s’y refuser, frileux d’entreprendre plus d’une décennie de travaux coûteux, à hauteur de 600 millions d’euros. Naïma Moutchou estime que “ce n’est pas praticable” compte tenu des conditions actuelles.
Elle n’en reste pas moins déterminée à faire de la lutte contre l’insécurité un fer de lance. En témoignent plusieurs alternatives proposées, comme celle d’un centre de semi-liberté favorisant la réinsertion et le lien social. La réalité actuelle reste néanmoins alarmante : jusqu’à cinq détenus dans dix mètres carrés, avec des conditions de détention qualifiées “d’inhumaines” par plusieurs parlementaires.
À plus long terme, le gouvernement évoque la possibilité de transférer certaines compétences régaliennes de l’État vers la Nouvelle-Calédonie. Mais ce mécanisme est extrêmement encadré et nécessiterait une majorité de 36 voix sur 56 au Congrès calédonien, soit un total de 64 % pour devenir effectif. Se voulant prévenante, la ministre maintient que ces évolutions devront s’inscrire dans un processus politique stabilisé et légitime.
Une situation hautement sensible que résume très bien la sénatrice polynésienne Lana Tetuani : “par respect pour nos amis calédoniens, il ne faudrait pas une heure, mais une voire deux journées de discussion en commission”. En ce sens, l’issue du processus sera déterminante pour stabiliser durablement la Nouvelle-Calédonie ou y raviver des fractures déjà profondément ancrées dans l’histoire locale.