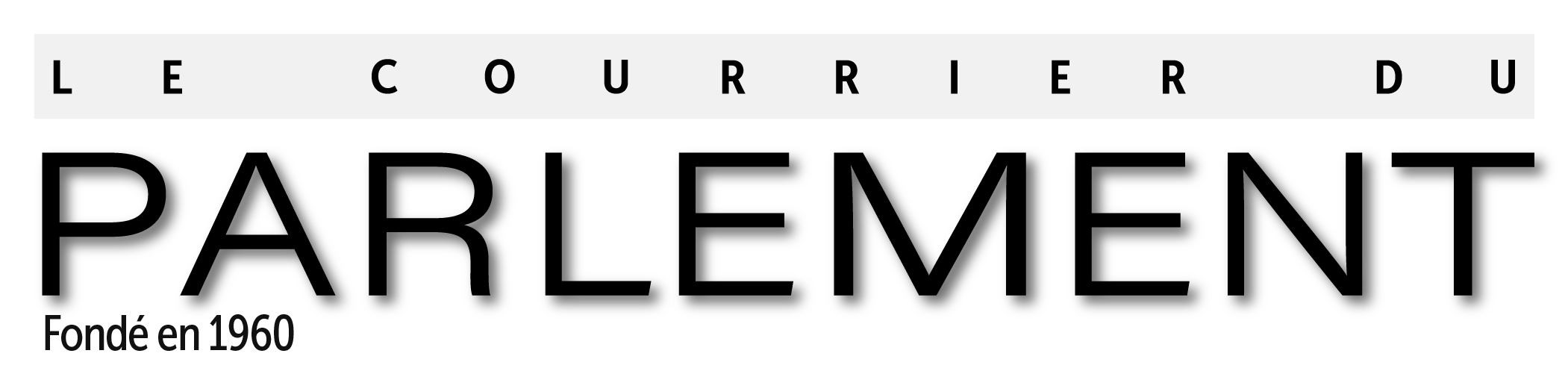La première économie ultramarine a vocation à ouvrir la voie pour innover et inventer l’Outre-Mer de demain. Récemment élue présidente du MEDEF Réunion, Katy Hoarau esquisse ce à quoi devront ressembler à l’avenir les activités comme les entreprises de l’île.
Vous venez d’être élue à la tête de la première organisation patronale de l’île. Toute la rédaction tient à vous adresser ses félicitations.
Merci. C’est un honneur d’avoir été élue par mes pairs, dans un esprit de rassemblement et de confiance. Cette élection marque un tournant : elle exprime une volonté partagée de travailler autrement, en jouant collectif, pour construire une économie réunionnaise plus robuste et mieux ancrée dans ses réalités.
La Réunion est le département d’outre-mer le plus peuplé et le premier en termes de PIB.
Quels sont les dossiers prioritaires auxquels vous allez devoir faire face ?
Le premier grand dossier, c’est la défense du dispositif d’exonération de charges patronales dans les Outre-mer. S’il venait à être affaibli, ce serait une remise en cause majeure de la compétitivité de nos entreprises. C’est un sujet vital pour les sociétés et pour l’emploi à La Réunion. A cet effet, nous avons déjà engagé une mobilisation conjointe avec les autres organisations patronales et les syndicats de salariés de l’île.
D’autres priorités suivent : structurer davantage les filières économiques, mieux accompagner les transitions écologique, numérique et générationnelle, et faire en sorte que la parole économique réunionnaise soit entendue au niveau national.
Quels objectifs vous fixez-vous pour ces trois ans de mandat ?
Ma feuille de route repose sur trois grands axes :
- jouer groupé, en rassemblant les forces économiques du territoire autour de sujets structurants ;
- créer un comité stratégique, adossé à des bases de données solides, pour éclairer les choix économiques et les politiques publiques ;
- travailler la robustesse de notre économie, en renforçant notre capacité à produire localement, à innover, à résister aux chocs.
Un premier point d’étape aura lieu en septembre, à l’occasion des MEDEF Business Awards, suivie d’une lettre des 100 jours qui sera adressée aux adhérents pour présenter les chantiers engagés et les perspectives.
La féminisation de la fonction apporte-t-elle quelque chose selon vous ?
Je ne suis pas présidente parce que je suis une femme, mais c’est un signal fort que je le sois. Cela montre que l’on peut franchir le plafond de verre, même dans des fonctions encore très masculines.
J’apporte sans doute une manière différente de diriger : plus horizontale, plus à l’écoute, mais tout aussi exigeante. Je crois à la force du collectif, à la lucidité stratégique et à la puissance du lien humain.
La Réunion représente près d’un habitant de l’outre-mer sur trois tout en « pesant » une bonne part de l’économie ultramarine. Pourriez-vous dépeindre brièvement le tissu économique réunionnais ?
La Réunion est le département d’outre-mer le plus peuplé et le premier en termes de PIB. C’est une économie à part entière dans l’ensemble ultramarin, avec ses propres enjeux de transformation.
Elle est vivante, diverse, et très majoritairement composée de TPE/PME. Elle repose sur quelques piliers solides comme la distribution, le BTP, le tourisme, l’agroalimentaire… mais elle est en pleine mutation. De nouvelles activités émergent dans le numérique, les énergies renouvelables, l’économie circulaire ou les services à la personne.
C’est une économie à la fois fragile par sa dépendance, et puissante par sa capacité d’adaptation.
Quels sont ses atouts et ses points faibles ?
Parmi ses atouts, je citerais :
- une jeunesse pleine d’idées ;
- un entrepreneuriat inventif ;
- une forte solidarité territoriale ;
- un ancrage culturel propice à la coopération.
Mais nous faisons face à plusieurs fragilités :
- une dépendance forte aux importations ;
- une vulnérabilité logistique ;
- une vie chère structurelle ;
- et parfois une certaine lourdeur administrative qui freine l’investissement.
L’outre-mer est souvent perçue comme une économie dépendante de l’agriculture, du tourisme et des aides de la Métropole. Cette idée se vérifie-t-elle selon vous ?
C’est une idée partiellement vraie mais très incomplète. D’ailleurs, il est plus juste de parler des outre-mer que de l’outre-mer car chaque territoire a ses spécificités. L’agriculture et le tourisme sont importants, et les aides de l’État compensent des handicaps structurels. Mais il ne faut pas enfermer l’outre-mer dans cette image.
À La Réunion, l’économie bouge. Elle innove, elle se transforme, elle crée de la valeur au-delà des clichés. Le rôle du MEDEF, c’est aussi de valoriser cette dynamique et de la rendre visible à tous les niveaux.
Je rêve d’une économie réunionnaise plus résiliente, plus sobre et plus souveraine.
Comment l’entrepreneuriat réunionnais contribue-t-il à la diversification économique de l’île ?
Les entrepreneurs réunionnais sont les premiers artisans de cette diversification. Ils créent de nouveaux modèles, notamment dans l’agrotransformation, l’économie bleue, la transition énergétique, la santé, la culture ou encore le numérique.
Ils inventent une économie plus proche, plus circulaire, plus en phase avec les réalités du territoire. Ce mouvement existe déjà, mais il doit aujourd’hui être renforcé, accompagné, mis en récit.
Comment envisagez-vous le visage de l’économie réunionnaise à l’horizon 2030 ?
Je rêve d’une économie réunionnaise plus résiliente, plus sobre et plus souveraine.
Une économie où les filières locales sont encore mieux structurées, où les jeunes trouvent des perspectives sur place, où les entreprises produisent plus de valeur localement. Une économie ouverte sur son bassin régional, mais aussi fière de ce qu’elle crée ici.
Et surtout, une économie à taille humaine, portée par des entrepreneurs qui ont à cœur de concilier performance, impact et engagement.